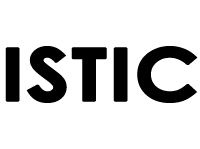Master Class 2024 :Toucher le client avec plus d’impact
« Pour toucher le client avec plus d’impact, les entreprises doivent prendre en compte plusieurs aspects, notamment la notoriété, la visibilité, la considération et la fidélisation. », monsieur Ivan BESSIN, Manager de l’Ecole du Code.
C’était le samedi 23 mars 2024 à l’ISTIC au cours de l’atelier de maître sur le marketing digital et le e-commerce, organisé dans le cadre de la phase 2 des Master Class 2024.

Master class 2024 : incursion dans les coulisses de l’atelier Radio
Les étudiants des filières Journalisme et Techniques et Technologies des médias sont repartis en deux ateliers pour les Masters class 2024.
Chaque atelier est chargé de réaliser des productions qui seront diffusées sur les différentes plateformes de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC), au nombre desquelles la radio ISTIC FM (88.9). Dans cet article, nous avons fait une incursion dans les coulisses du service rédaction de l’atelier Radio.
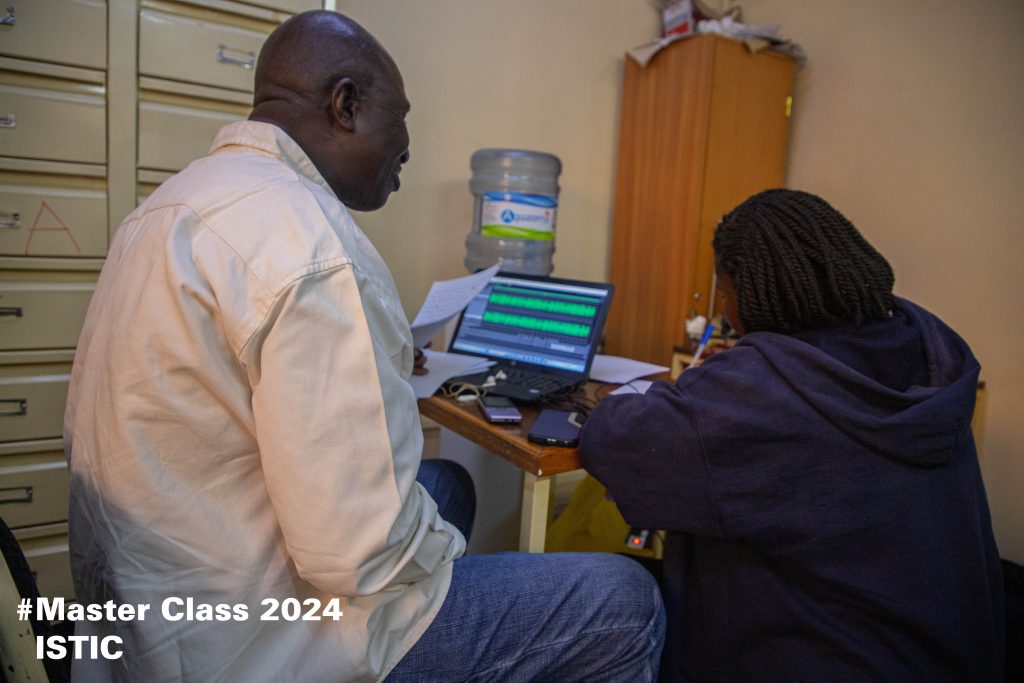
Le processus de production d’un journal parlé en général et celui de ISTIC FM en particulier demande une organisation minutieuse. Selon Alima YOGO, journaliste à ISTIC FM, « Le suivi de toutes les étapes cruciales est nécessaire pour offrir une belle expérience informative aux auditeurs. Tout commence par la rédaction composée de journalistes, avec des rôles spécifiques ». A l’ISTIC Fm, les rôles sont attribués de façon tournante. Chaque jour, une nouvelle équipe est chargée de préparer le journal. Cette équipe est composée d’un (e) rédacteur (rédactrice) en chef, d’un présentateur ou d’une présentatrice et des journalistes reporters. « Chaque matin, à partir de 8 heures, nous avons la conférence de rédaction au cours de laquelle nous décidons du menu du journal du jour », dixit Yolande GALBANE, rédactrice en chef du jour. Son rôle est de se s’occuper de la programmation des reporters et du recensement des sujets de reportage en collaboration avec ses collègues. Elle est aussi chargée de préparer les brèves et les conducteurs en attendant le journal.
Offrir une belle expérience informative
Quant à la présentatrice du jour, Romaine SAWADOGO, elle a indiqué qu’elle est chargée d’agencer les éléments du journal et de trouver des titres en complicité avec le rédacteur en chef pour être en conformité avec la technique. « Les journalistes reporters collectent, rapportent des informations sur l’actualité du jour et font des papiers d’initiative privés. Ils rédigent des scripts détaillés qui serviront de base pour la présentation. Le ton, la clarté et la concision du présentateur (présentatrice) sont essentiels pour maintenir l’attention des auditeurs », a ajouté Romaine SAWADOGO.
Cette coordination entre les différentes étapes d’une part, et entre les différents acteurs d’autre part, depuis la sélection des actualités jusqu’à la diffusion finale, vise à offrir une belle expérience informative aux auditeurs, a déclaré Yolande GALBANE.
Groupe II / Atelier communication
En savoir +
APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’ETUDIANTS AU TITRE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2023-2024
La Directrice Générale de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) a l’honneur de porter à la connaissance du public, que la réception des dossiers de candidature pour le recrutement sur titre d’étudiants aura lieu du 21 août au 04 septembre 2023. Les offres de formation professionnelle, pour le compte de la rentrée académique 2023-2024, portent sur les filières et niveaux suivants :
- Assistant en Journalisme
- Conseiller en Journalisme
- Assistant en Communication
- Conseiller en Communication
- Technicien Supérieur des Techniques de l’Information et de la Communication
- Ingénieur des Techniques de l’Information et de la Communication
CONDITIONS D’ADMISSION ET DIPLOMES DELIVRES
Les conditions d’admission à l’ISTIC et les diplômes délivrés se présentent par filière et par niveau comme suit :
I. JOURNALISME
Diplômes requis :
- Baccalauréat toutes séries ou équivalent ⇒ Diplôme d’Etat d’Assistant en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (BAC+2);
- Licence toutes options ou équivalent ⇒ Diplôme d’Etat de Conseiller en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication : (LICENCE + 2).
II. COMMUNICATION
Diplômes requis :
- Baccalauréat toutes séries ou équivalent ⇒ Diplôme d’Etat d’Assistant en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (BAC + 2);
- Licence toutes options ou équivalent ⇒ Diplôme d’Etat de Conseiller en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication : (LICENCE + 2).
III. TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES DES MEDIAS
Diplômes requis :
- Baccalauréat série scientifique, technique / Diplôme d’Etat de Technicien Supérieur des Sciences de l’information et de la communication (BAC+2);
- Licence série scientifique, technique ou équivalent / Diplôme d’Etat d’Ingénieurs des Techniques de l’information et de la communication: (LICENCE + 2).
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature se compose des pièces suivantes :
- Une demande manuscrite timbrée (timbre fiscal) à 200 FCFA, adressée à madame la Directrice Générale de I’ISTIC, précisant la filière et le niveau de formation souhaités
- Une photocopie légalisée du diplôme exigé ou de 1’ attestation ou de 1’équiva1ent ;
- Une photocopie légalisée du relevé de notes du BAC ;
- Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif ;
- Une photocopie légalisée de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) en cours de validité ;
- Un curriculum vitae actualisé, rédigé sur une (1) page maximum ;
- La quittance de versement de la somme de 15 000 F CFA, représentant les frais d’inscription non remboursable, à payer à l’agence comptable de 1’ ISTIC.
DEPOT DES DOSSIERS
Les dépôts de dossiers peuvent se faire du lundi 21 août au lundi 4 septembre 2023, à :
- ISTIC-Ecole sis Koulouba/ Ouagadougou : Salle 8, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h
- Par email (dossiers scannés) aoussegueabem@gmail.com/ badam1021@yahoo.fr/
somda.saturnin@yahoo.fr pour les personnes hors du pays.
NB : Tout dossier incomplet sera rejeté.
CONDITIONS D’ADMISSION FINALE
Les candidats retenus prendront part à un test de sélection définitive basé sur les épreuves
suivantes :
- Epreuve de culture générale : le jeudi 7 septembre 2023
- Epreuve d’entretien oral : les 8 et 9 septembre 2023
NB : le port de la tenue scolaire est obligatoire durant le cycle de formation.
Contacts : +226 70 26 93 20(WhatsApp) / +226 75 13 48 66 (WhatsApp) / +226 25 36 25 58/ +226 76 33 76 37 (WhatsApp)
ISTIC, le creuset du Journalisme et de la Communication au Burkina Faso !
La Directrice Générale
Dr Alizeta OUOBA/COMPAORE
En savoir +
Voyage pédagogique bobo 2023 : c’en est fini pour le partage d’expériences dans la cité de Sya !
Après plus d’une semaine de dur labeur, les équipes d’encadrement, de l’administration ainsi que celles des stagiaires ont quitté la cité de Sya et sont arrivées dans la soirée du 8 mai 2023 à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) à Ouagadougou.
Plus d’une soixantaine de stagiaires de la 35e promotion du niveau assistant de l’ISTIC ont pu bénéficier de ce traditionnel partage d’expérience à Bobo-Dioulasso auprès de leurs encadreurs. Ces derniers n’ont ménagé aucun effort pour les accompagner. Le voyage pédagogique s’inscrit dans le processus de formation professionnelle des stagiaires.
Et comme toute chose a une fin c’est ce 8 mai 2023 que les stagiaires de l’ISTIC sont rentrés de leur voyage pédagogique.
Visites d’entreprises de presse, d’industries et la réalisation de reportages sur les activités de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), de capsules vidéos, d’ albums photos, la conception d’affiches, la réalisation de lives, étaient entre autres les différents exercices auxquels se sont prêtés les stagiaires de l’ISTIC durant cette sortie.
Sur le chemin du retour, c’est somme toute une ambiance de joie qui a régné. Si certains étaient contents de rentrer, d’autres par contre espéraient une prolongation du voyage .
Le 1er car qui a démarré à 8h34 semblait transporter des étudiants impatients de regagner leur ‘’chez eux’’.
En fait dans ce car on aurait dit que les petits plats avaient été mis dans les grands pour agrémenter le voyage retour.
En effet , tout y semblait avoir été bien préparé . Un DJ improvisé qu’accompagnait une maîtresse de cérémonie animaient et égayaient l’atmosphère dans le car. On eu dit qu’il s’était préparé en conséquence au vu de la sélection musicale qui enflammait le car.

Dans le premier car , les stagiaires criaient tous de joie
Cris, rire, chant, coups de téléphone à gauche à droite pour prévenir de leur arrivée retentissaient dès les premières heures jusqu’à ce qu’une bonne partie sombre dans les bras de Morphée .

Ce partage d’expérience à Bobo-Dioulasso, en Web journalisme a été très enrichissant pour les étudiants
Après quelques heures de sommeil et du chemin parcouru, vint un moment de délivrance marqué par une pause santé.11h30, le car est à Boromo. Et une pause de 30 minutes est offerte à l’ensemble des voyageurs pour leur permettre de se restaurer . A 12h10, ils se réinstallent dans le car. La traversée continue avec pour destination Ouagadougou.
L’ambiance diminue d’intensité dans le véhicule au fur et à mesure que la destination approche.
A 14h30 nous voilà dans la commune de Tanghin Dassouri.
Des 15h30, la voiture se gare au parking de L’ISTIC et nous voilà dans la cour . L’ambiance a repris de plus belle. Cette fois pour se dire au revoir et rejoindre les proches venus attendre les stagiaires après près de deux semaines d’absence.
Groupe B
Hadéja KEITA
Jémima KABRE
Leila BARRY
Aissata TASSOMBEDO
Hania OUEDRAOGO
Roxane KABORE
En savoir +
Voyage pédagogique 2023 : Une soirée cinématographique organisée entièrement par les stagiaires assistants de la 35e promotion de l’ISTIC
90 sièges assis, renforcés par une vingtaine de chaises, la salle du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) de Bobo-Dioulasso, a refusé du monde suite à la soirée cinématographique organisée par les Isticiens le 4 mai 2023. De l’administration au corps enseignant en passant par les étudiants, l’Institut des Sciences et Techniques de I ’information et de la Communication (ISTIC) a été magnifié au cours de cette soirée cinématographique.
Cela fait 8 jours que les stagiaires sont en immersion à Bobo-Dioulasso dans le cadre du renforcement de leur capacité professionnelle. A cet effet, ils ont organisé une soirée cinématographique afin d’ expérimenter la conception et le déroulement des événementiels . Cette soirée a connu la présence de la Directrice Générale de l’ISTIC , d’invités et de partenaires de l’institut.
Le programme des activités, les différentes invitations, les affiches, les flyers, le speech, la préparation de la salle, l’installation des invités, ont tous été portés par les étudiants en communication.
Quant à ceux de la filière journalisme, ils ont assuré la couverture médiatique de ladite soirée à travers la réalisation d’un grand direct et d’une vidéo Mojo.
Les techniciens ont quand à eux assuré la sonorisation et la projection des deux films qui étaient au programme ainsi que de l’exécution du direct.
Les films projetés sont des productions d’étudiants de promotion antérieure .
Il s’agissait du film documentaire, de Nourate Tontorogbo de 26minutes 46 seconde tourné à Kaya, manga et Ouaga durant l’année 2020- 2021, intitulé, « Tramadol un mal silencieux ». Ce film parle de l’impact négatif des stupéfiants sur la santé des jeunes. Pour la réalisatrice, ce film est une invite aux autorités à prendre des mesures appropriées pour éradiquer ce mal qui détruit la jeunesse Burkinabè.
« La stigmatisation de l’albinos au Burkina Faso, double peine pour défaut de la mélanine » est le second film projeté à l’occasion de la soirée cinématographique. Dans ce documentaire de 26 minutes 9 secondes. Zalissa Zongo, un produit de L’ISTIC, traite du phénomène de marginalisation auquel les personnes albinos sont confrontées.

La Directrice Générale , Alizèta Woba/Compaoré, a félicité l’ensemble des stagiaires et a encouragé les encadreurs à toujours rester disponible pour accompagner les apprenants.
La Direction de la Formation Initiale a remercié tout le corps enseignant pour l’accompagnement et la qualité du travail abattu tout au long du processus de formation des étudiants. La directrice générale quant à elle a salué l’intérêt que le public a porté à cette soirée.
En rappel le voyage d’études a pour rôle de permettre aux étudiants d’être en situation réelle avec les réalités du terrain mais aussi de mettre en exergue leurs aptitudes à s’adapter aux réalités du terrain.
Toute chose qui devrait concourir à faciliter leur insertion professionnelle.
Groupe B
Hadéja KEITA
Jémima KABRE
Roxane KABORE
Hania OUEDRAOGO
Aissata TASSOMBEDO
Leila Barry

Voyage pédagogique Bobo 2023 : Les stagiaires de la 35e promotion de l’ISTIC à la découverte de la SN-CITEC

C’était autour de la Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie (SN-CITEC) de recevoir la visite des stagiaires de la 35e promotion de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC). Dans le cadre de leur voyage pédagogique à Bobo-Dioulasso, le 4 mai 2023, ils y ont fait un tour. De la transformation de la graine de coton à la production de l’huile et du savon, les apprenants se sont imprégnés des innovations prévues par la SN-CITEC.
La SN-CITEC est l’une des principales industries du Burkina Faso opérant dans le secteur des oléagineux, à travers la production d’huile alimentaire, de tourteaux de coton et d’aliments pour bétail à base de graine de coton. Elle produit également du savon de ménage à base de matières premières importées de la sous-région.
Dans le souci de comprendre le mécanisme de transformation de cette matière première qu’est le coton en savon et en huile, les stagiaires de l’ISTIC sont allés visiter les locaux de l’industrie en compagnie de leurs encadreurs et de quelques membres de l’administration. La transformation de la graine, issue de la culture du coton produit par des millions de paysans, constitue une valeur ajoutée pour l’économie nationale burkinabè.

Selon le responsable de raffinage et de conditionnement, Lionel Sanon , 6000 bidons d’huile sont produits chaque 8 heures, et 30 tonnes de savons par jour.
Cette société ravitaille le pays en quatre produits essentiels, à savoir l’huile Savor, le savon Citec, les tourteaux et l’aliment pour bétail. A entendre le responsable du raffinage et du conditionnement, Lionel Sanon, ce travail s’étale sur une durée de 11 mois sur 12 avec un mois de maintenance pour les machines. La matière première utilisée dans la production des différents produits est la graine de coton. Et pour ce faire, il y a une section de stockage qui est chargée de la recevoir et de la stocker afin que l’usine puisse produire durant 11 mois. « La société a une capacité de stockage d’environ 120.000 tonnes par an. Mais ces dernières années, elle ne parvient qu’à stocker 60.000 tonnes », a expliqué M. Lionel Sanon.
Selon M. Sanon, cette graine subit plusieurs transformations avant de donner les produits finis de l’usine. Il s’agit d’abord du nettoyage et du décorticage de la graine pour la débarrasser des impuretés. Et puis, il y a la ventilation et le tamisage qui permettent de dégager la poussière et les particules étrangères de la graine. Elle est après envoyée pour le décorticage et les amandes sont ensuite récupérées. « La société dispose de 3 nettoyeurs, 5 batteurs et 8 décortiqueurs », a révélé le responsable du raffinage et du conditionnement. Après ce processus, la graine est aplatie et transformée en une farine qui passe par la cuisson, pour donner une pâte qui sort à une température de 100°C. Toutefois, il faut un conditionnement de 30°-37°, avant de passer à l’extraction de l’huile.
Quant au savon citec, il est obtenu grâce au mélange d’acide gras de palme, de sel, de soude et d’huile de palmiste.

Cette visite a permis aux étudiants de toucher du doigt les réalités de la SN-CITEC de Bobo-Dioulasso.
Des innovations en cours
L’insécurité affecte tous les secteurs d’activités. C’est le cas de la SN-CITEC, qui fait face à un problème d’approvisionnement en graine de coton, ces dernières années. Pour pallier à ces manquements, la SN-CITEC a inscrit dans son projet, la production d’huile à base de graine de soja.
En rappel , la SN-CITEC a été créée le 1er novembre 1995.
Groupe B
Hadéja KEITA
Jémima KABRE
Roxane KABORE
Hania OUEDRAOGO
Aissata Tassombedo
Leila Barry

Master Class 2023 : les acteurs apprécient au 4è jour de la première phase
La première phase des masters class, débutée le mercredi 22 février 2023 à Ouagadougou, se poursuit jusqu’au 5 mars 2023. A l’ouvrage, des journalistes, des communicants et des techniciens réalisent des productions médiatiques et des supports de communication, visibles sur les différentes plateformes numériques de l’institut. Quatre jours après, une équipe a recueilli les avis d’un stagiaire et d’un encadreur qui apprécient le déroulement des master class.

Alfred NIKIEMA/ Journaliste
« Cette année, il y’a beaucoup d’évolutions car les étudiants s’adonnent encore mieux que les années précédentes. Il y’a de la bonne graine, mais il y a aussi des problèmes qu’il ne faut pas occulter. Le problème principal est le niveau de culture, car quand on veut aller au journalisme il faut de la matière, il faut se cultiver à tous les niveaux. Il y’a également des mécontentements, des incompréhensions et voire des disputes entre les stagiaires qui sont liés à des questions de leadership. Certains proposent des idées qui sont contestées par d’autres et nous prenons en compte tout cela».

Adeja KEITA, stagiaire en journalisme
« Au début, ce n’était pas facile pour nous, mais grâce à l’appui de nos encadreurs, on s’en sort de mieux en mieux. Nous pouvons dire qu’à cette étape ça va parce que nous pouvons animer plus facilement, sans stress »

Rokia ADJIOUBOU, stagiaires en Communication
« Par rapport au premier jour des Masters class, Le quatrième jour se déroule bien dans son ensemble. Nous exécutons les tâches avec plus de zèle et de facilité grâce à nos encadreurs qui nous apportent leurs soutiens dans nos réalisations. Tout se passe dans une très bonne ambiance ».
De l’avis de ces personnes interrogées, le bilan de ces quatre jours est satisfaisant et très instructif. La journée s’est terminée en beauté avec la participation des stagiaires à la cérémonie officielle d’ouverture du FESPACO qui a eu lieu à 15h au palais des sports de Ouaga 2000. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage de son excellence Monsieur le Premier Ministre, chef du gouvernement, avec comme pays invité d’honneur, le Mali.
Master Class/ ISTIC
En savoir +