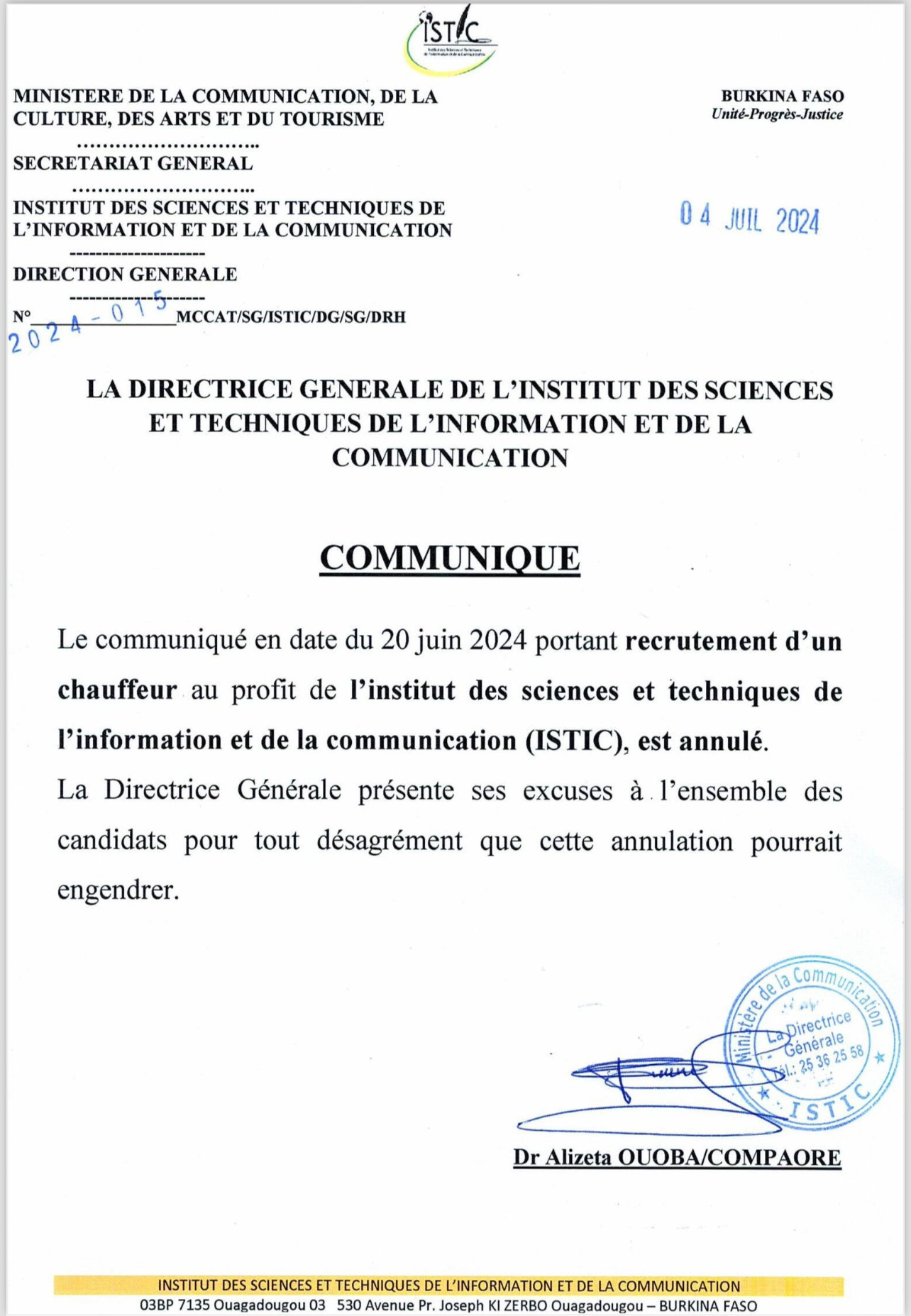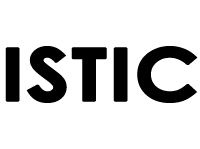Clôture SNC Bobo 2024 : un bilan positif dressé
Le Premier Ministre Me Kyélem de Tambèla a donné ce samedi 04 Mai 2024, les six coups de balafon marquant la fin de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) édition 2024. Et les commentaires disent « ni SNC ni, a diarra ». Ce qui signifie en français, « cette SNC a été une réussite ». Et l’édition 2026 se prépare déjà.

La salle était pleine à craquer pour cette cérémonie de clôture de la SNC
Les rideaux sont officiellement tombés ce samedi 04 mai 2024 à la maison de la culture de Bobo-Dioulasso, sur la 21e SNC. Sa Directrice générale, Christiane Sanou/Coulibaly a dressé le bilan de toutes les activités menées au cours de cette édition. En ce qui concerne la cérémonie d’ouverture de cette édition le 27 avril 2024 au stade omnisport Sangoulé Lamizana, elle a été un véritable succès avec la présidence du chef de l’État le Capitaine Ibrahim Traoré.
La foire artisanale s’est tenue du 28 avril au 3 mai 2024 au siège de la SNC. Durant ces jours, plusieurs exposants venus d’ici et d’ailleurs ont proposé leurs produits à plus de 300 000 visiteurs.
Le village des communautés et de la gastronomie africaine a été une vitrine de la valorisation du patrimoine africain et 45 nationalités étrangères y ont participé.
Rendez-vous en 2026
Le discours officiel de clôture de la SNC 2024 a été prononcé par le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il a remercié l’ensemble des acteurs et s’est prononcé sur les perspectives. « Je voudrais à cette occasion traduire toute mon admiration aux différents compétiteurs et permettez moi d’inscrire vos noms sur la liste des gens qui marqueront à jamais l’histoire de cette nation (…). Je voudrais rappeler que la semaine nationale de la culture a été érigée en établissement à caractère administratif de l’Etat. Des perspectives seront prises en vue de meilleures performances pour les éditions à venir », a déclaré le ministre.
Il a terminé son discours en saluant les forces de défense et de la sécurité ainsi que les VDP.
Le ministre d’Etat a enfin lancé une invitation à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture qui se tiendra en mars 2026.
Des compétitions régionales seront organisées en 2025 dans cette perspective.
A noter que l’UNICEF a offert un véhicule à la SNC.
Cette cérémonie de clôture a été marquée également par la proclamation des résultats des différentes disciplines du Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL) et la remise d’attestations aux différents lauréats.

Remise d’attestation aux lauréats
En rappel, la SNC se déroule tout les deux ans au « Pays des Hommes intègres ».
Cette 21eme édition avait le Niger comme pays invité d’honneur.
Membres du groupe
Djamila Compaoré
Faridatou Bélem
Jessica Gamené
Yolande Galbané
Sylvie Soubeiga
Tegwendé Zoundi
En savoir +
Promotion culturelle au Burkina Faso : le CSC sensibilise les médias
Dans le cadre de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé ce jeudi 02 mai 2024, une conférence publique à la chambre de commerce de Bobo-Dioulasso.
« La régulation des médias permet de valoriser la diversité culturelle en donnant des espaces aux différentes communautés. Elle permet la promotion de la culture nationale en favorisant la production et la diffusion des contenus culturels », soutient d’entrée Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, vice-président du CSC et conférencier du jour. Mettant en lumière le rôle des médias, la régulation se veut être garant de la liberté d’expression culturelle, de la diversité culturelle et de la préservation de nos mœurs.

Louis modeste Ouédraogo, conférencier et vice-président du CSC-photo. D Ouédraogo
Selon le conférencier, la régulation est également un moyen de protection culturelle en garantissant l’identité culturelle. « La régulation dans son rôle de protection est comme un gendarme entre la culture occidentale et notre culture. De même entre les cultures du pays », ajoute-il dans la suite de sa présentation.
« La régulation des médias et la protection culturelle sont deux piliers essentiels de la souveraineté d’un pays », a laissé entendre Baba Hama, modérateur de la conférence lors de sa synthèse, avant d’ajouter : « il y a de quoi trouver un équilibre entre la régulation nécessaire pour protéger la souveraineté nationale ».
La régulation des médias est un outil essentiel de la liberté d’expression culturelle, de la promotion culturelle, de la protection culturelle afin de garantir la souveraineté culturelle et nationale.
Pour les participants, cette tribune d’échanges est un moment d’éclairage. « La conférence était une véritable école en ce sens qu’elle nous a permis de comprendre la place qu’occupe le CSC dans la régulation des médias et le rôle de ces derniers pour la promotion de la culture burkinabè », confie Florencia Zoundi, stagiaire à l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la communication (ISTIC).

Les participants ont rempli la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’industrie de Bobo-photo. D Ouédraogo
Placé sous le thème : « régulation des médias et promotion culturelle, enjeux de souveraineté », cette conférence publique s’inscrit dans la première participation du CSC aux activités de la SNC. Elle a connu la présence des étudiants, des professionnels des médias et des acteurs culturels.
Eugène KAM
Julie THIOMBIANO
Anna ZOMBRA
Seyni YAMEOGO
Cécille SAWADOGO
Rahimatou SAWADOGO
Fideline BANCE

Soirée cinématographique Bobo 2024 : les talents Isticiens positivement appréciés
Les stagiaires assistants en fin de formation de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC) ont organisé ce mercredi 1er mai 2024 une soirée cinématographique à la salle Casimir Koné au sein de la RTB2 Hauts-Bassins.
La soirée cinématographique, organisée dans le cadre de leur voyage pédagogique, en est l’une des plus grandes activités.

Dr Sita Diallo/ Traoré apprécie et encourage les Isticiens pour la réussite de la soirée cinématographique.
La Directrice de la Formation Initiale, Dr Sita Diallo, a expliqué que l’ISTIC offre une formation de qualité à ses stagiaires et cela est remarqué à travers leur production de fin de cycle.
Les films projetés sont respectivement “ALLÉLUIA/ALHAMDOULILAH, pour le meilleur et pour le pire”, de Rasmané Zongo et “LA PRISE EN CHARGE DES PDI : le sacrifice des familles Hôtes” de Amandine Tago.

Amandine Tago, réalisatrice du film « la prise en charge des PDI par les familles hôtes » attentive à la projection de son œuvre.
Amandine Tago est de la 35e promotion de l’ISTIC. « Les conditions de réalisation n’ont pas été faciles, mais avec l’appui de mes encadreurs, de mes camarades et de tout le personnel de l’ISTIC, j’y suis arrivée. Le message caché derrière cette réalisation est la solidarité agissante, la cohésion sociale et les valeurs d’accueil, d’hospitalité », a-t-elle déclaré.
Amandine Tago déclare être honorée par le choix de son film et fière d’être acclamée par ses jeunes cadets et le public.

Le public captivé par la projection cinématographique.
Pour Yasmine Karanga, venue assister à cette soirée, c’est l’émotion après avoir regardé ces deux films. Elle a surtout positivement apprécié le film sur les personnes déplacées internes, tout en affirmant qu’après sa soutenance à l’université Nazi Boni, elle compte s’inscrire à l’ISTIC pour bénéficier de cette formation de qualité.
« Je tiens à féliciter les différents réalisateurs du film et je leur souhaite beaucoup de courage pour la suite », a-t-elle déclaré.
Membres du groupe
Prisca Dédoui
Innocent Ilboudo
Pascaline Kalmogo
Olivia Lankoandé
Bibata Naon
Boukaré Ouédraogo
Nathalie Yabré
En savoir +
SNC Bobo 2024 : Les Isticiens sur les ondes de la Radio nationale
Les stagiaires de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la communication étaient au micro du 1012 de la radio nationale.
Lors des échanges, les stagiaires ont présenté l’ISTIC et ses offres de formation.
Les Isticiens ont aussi situé le contexte des masters class et des voyages pédagogiques qui viennent approfondir les connaissances théoriques des stagiaires avec la pratique.
Ce mai 2024, l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication souffle la bougie de son cinquantenaire.
Les stagiaires ont donc profité de l’occasion pour présenter les activités qui seront menées lors de cette célébration.
Dans le cadre du voyage pédagogique, une soirée cinématographique est organisée par les Isticiens. A cette occasion, les stagiaires ont lancé une invitation à la population bobolaise afin qu’ils viennent nombreux à cette projection.
En savoir +

GPNAL de la SNC 2024 : le défi des « jeunes Yissuenon de Zangboni »
La troupe « jeunes Yissuenon de Zangboni » participe au Grand prix national des arts et des lettres dans la catégorie danse traditionnelle. Elle est en lice pour leur première fois à la Semaine Nationale de la Culture dans le pool jeunes et espère remporter le trophée.
Le battement du tam-tam, la mélodie des balafons et des flûtes rythment la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso à notre arrivée à 11h30. Nous apercevons de jeunes enfants qui exécutent des pas de danse “endiablés “. Leur vivacité nous attire vers eux et nous découvrons que cette troupe s’appelle « jeunes yissuenon de Zangboni ». Yissuenon en langue pougouli signifie en français “la culture ne doit pas être abandonnée”.

Les artistes musiciens de la troupe
Composée de 7 filles et de 5 garçons entre 7 et 15 ans, ces enfants bougent au rythme de leur musique. Ce travail se fait sous la supervision de leur coordinateur, Albert Malo.
Originaires de Zangboni, ces artistes de la communauté pougouli se battent pour la reconnaissance de leur patrimoine culturel.
C’est en 2023 que monsieur Malo a estimé nécessaire de planter une graine d’espoir en ces jeunes en mettant sur pied la troupe jeunes Yissuenon de Zangboni.

Albert Malo, coordonnateur de la troupe jeune Yissuenon de Zangboni
« C’est au regard de la motivation des enfants que nous avons décidé de participer au GPNAL de la SNC », souligne le coordinateur. Il nous confie également que la majorité des membres de leur village ne croit pas en leur troupe et trouve leur participation à la compétition vaine. C’est la raison pour laquelle ils redoublent d’effort pour être à la première place pour ne pas décevoir la minorité qui croit en eux.
Tout pour la victoire
Depuis septembre 2023, Albert Malo prépare ses artistes à affronter la rude concurrence. Ils effectuent des allées et retours de 195 km entre Bobo et Zangboni pour leurs répétitions. Il rapporte à ce sujet que « le déplacement et l’hébergement des enfants sont à mes frais ».
En tant que responsable de ce groupe d’enfants, monsieur Malo se doit de toujours rassurer leurs parents. Il doit aussi supporter les caprices des mineurs.
Albert Malo espère que sa joyeuse équipe aura l’occasion de se produire sur des scènes à l’extérieur. Mais d’abord, l’objectif ultime est de sortir vainqueur du GPNAL pool jeune et établir une bonne réputation de la troupe.
En rappel, un groupe artistique sous le nom « Yissuenon de Zangboni » existait il y a 40 ans dans le même village de Zangboni, mais s’est fait oublier parce qu’il ne remportait aucun prix. En 2023, Albert Malo a décidé de reconstituer la troupe avec des candidats plus jeunes et espère qu’ils feront l’exception.
Groupe A
Jessica Gamené
Djamila Compaoré
Yolande Galbané
Tégwendé Zoundi
Faridatou Belem
Sylvie Soubeiga
En savoir +
SNC 2024 : C’est parti pour les activités littéraires !
« Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau », c’est sous ce thème que se sont tenues à la Chambre de commerce et d’industrie de Bobo-Dioulasso les activités littéraires et le colloque de la 21e édition de la SNC 2024.
La cérémonie d’ouverture des activités littéraires et du colloque s’est tenue ce lundi 29 avril 2024 à la Chambre de commerce et d’industrie de Bobo-Dioulasso. Elle a été présidée par le ministre d’État, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO.

Le thème de la conférence a captivé l’attention du public – photo : Nathalie Yabre
Jacques Sosthène Dingara, ministre en charge de l’éducation nationale, représentant le ministre chargé de l’enseignement supérieur, a salué la création d’un cadre d’échanges entre spécialistes. Il affirme que cette initiative est à perpétuer lors des futures éditions de la SNC.
« Je félicite le comité national d’organisation pour avoir associé des enseignants chercheurs à l’organisation de cette rencontre scientifique », a-t-il indiqué.

Abdourahamane Amadou le ministre nigérien en charge de la culture – photo : Nathalie Yabre
La conférence inaugurale, modérée par le Professeur Salaka Sanou, a été assurée par Magloire Somé, professeur titulaire d’histoire contemporaine à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou. Il a avancé que la mémoire historique, trop chargée de passion, d’enjeux politiques et sociaux ne saurait être un facteur de sursaut patriotique, qu’à la condition que la demande d’histoire ne soit pas celle d’une histoire mémorielle.
La délégation nigérienne, avec à sa tête, le ministre nigérien de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Abdourahamane AMADOU, était présente à la cérémonie d’ouverture.
A la sortie de la cérémonie, le ministre burkinabè chargé de la culture, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a visité les différents stands, accompagné de son homologue du Niger.
Membres du groupe
Prisca Dedoui
Innocent Ilboudo
Nathalie Yabre
Pascaline Kalmogo
Olivia Lankouande
Biba Naon
Boukaré Ouédraogo
En savoir +